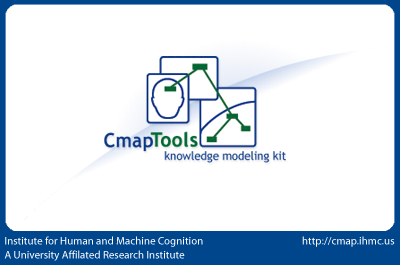Dans le contexte scolaire, il est souvent pris pour
acquis que l’école secondaire constitue, pour l’élève, la construction d’une
nouvelle culture, une culture dite seconde. À priori, l’élève possède déjà une
culture première forgée par les éléments sociologiques extérieurs, tels son
mode de vie, ses attitudes, ses croyances, son comportement. La culture seconde
se réfère plutôt à l’ensemble des œuvres produites dans le monde et dont
l’enseignant doit en devenir le passeur culturel. Le but de ce texte est de
décrire quel type de passeur culturel je souhaite devenir et comment vais-je
m’y prendre. Pour ma part, je souhaite devenir un médiateur engagé de type
instrumentaliste, afin que mes élèves s’engagent, tout comme moi, à entrer en
relation avec la culture.
D’abord, il est important de cibler ce qui
différencie un enseignant qui vous donne le plaisir d’apprendre comparativement
à un autre qui vous dégoute à un tel point de ne plus être intéressé par la
matière? Tel l’explique Gauthier (2001), ce n’est pas l’absence de la culture
comme objet de savoir, car tous deux connaissent leur matière sur le bout des
doigts. Il s’agit plutôt du rapport avec le savoir qui est absent chez le
deuxième. L’on pourrait donc dire qu’être une personne cultivée ne se résume
pas qu’à la culture en tant qu’objet de savoir, mais qui doit être accompagnée
de la culture en tant que rapport. Selon Simard (2002), «Enseigner, c’est aussi,
d’autre part, faire œuvre de médiation par rapport à la culture du passé et du
présent». Il sera essentiel de connaître l’histoire et l’épistémologie de ma
discipline pour en faire des liens entre la culture du passé et celle du
présent. Démontrer, par exemple, pourquoi la guerre entre l’héliocentrisme et
le géocentrisme fut si longue et en quoi l’héliocentrisme déplaisait-il tant
certaines personnes à l’époque. Des exemples comme celui-ci me permettront de
montrer aux élèves à quel point certaines découvertes ont été bénéfiques ou non
pour la société actuelle. Pour revenir à la culture par rapport au savoir, c’est
dans cette que naît la motivation à vouloir apprendre chez un élève et c’est
également pour cette raison que le programme de formation est constitué de
cours pédagogiques et didactiques. Dans le cas contraire, il n’y aurait aucunes
différences entre un chimiste et un professeur de chimie.
Donc, l’objectif à atteindre serait d’être une
personne suffisamment cultivée pour transmettre mes savoir, en leur permettant
de créer des rapports culturels vis-à-vis eux-mêmes, au monde, et aux autres. Tel
dit plus haut, mon type de rapport face à la culture serait plutôt instrumentaliste,
en utilisant d’abord la culture par rapport au savoir pour rendre les cours
intéressant, mais en ayant comme objectif second de me rapprocher du rapport à
la culture de type intégratif-évolutif. Je souhaite favoriser leur appropriation
de la culture afin qu’ils se questionnent et questionnent les autres pour se
redéfinir, mais bien sûr, ceci vient avec le temps avec l’accumulation des
connaissances. Ce ne sont pas tous les élèves qui sont dans la mesure d’effectuer
ce genre de réflexion et c’est pour cette raison que ceci constitue un objectif
et non une obligation
Pour conclure, me suffira-t-il d’être un enseignant
cultivé pour transmettre la culture seconde à mes élèves? Bien sûr que non, il
me nécessitera également de mettre au point des stratégies appropriées et
diversifiées pour la leur rendre accessible. Par exemple, des projets
humanitaires, des projets écologiques en liens avec les centres de recyclage de
la ville, des collectes d’objets pour une fondation quelconque, etc. Le plus
important sera de m’intéresser à ce qui les entoure et les anime pour
constituer ces projets, car tel le dit Zakhartchouk (1999), « un enseignant
doit d’abord savoir écouter ses élèves».
Nouvelle schématisation de la culture :
Référence
bibliographique
Zakhartchouk, Jean-Michel ,L’enseignant, un passeur culturel, ESF éditeur 1999
Simard, Falardeau, Émery-Bruneau et Côté, En amont d’une approche culturelle de
l’enseignement : le rapport à la culture, Érudit, Revue des sciences
de l'éducation, vol. 33, n° 2, 2007, p. 287-304.
Simard, D, Comment
favoriser une approche culturelle de l’enseignement, Vie pédagogique 124,
septembre-octobre
Gauthier, C, Former
des pédagogues, Vie pédagogique 118, février-mars